 |
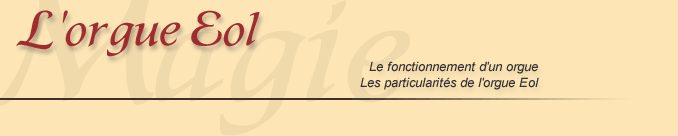 |
|
La
mécanique des orgues
(suite) A la fin du siècle dernier et jusque vers 1970, on a cru que la transmission électrique des claviers aux soupapes était la panacée, éliminant tous les problèmes de dureté de jeu et la plupart des pièces mécaniques. La recherche d'une interprétation authentique de la musique ancienne (Bach, Couperin, Grigny, etc.) a mis en évidence la nécessité d'une transmission mécanique en vue d'un jeu subtil et sensible qui fait parler les tuyaux avec précision, faisant entendre les variétés dans le bruit d'attaque au décollement des soupapes, plus ou moins d'harmoniques du son, des variétés aussi à l'arrêt du son, toutes choses qui s'entendent sur les bons instruments. C'est pourquoi, les restaurations actuelles retransforment les orgues électrifiés en orgues mécaniques, chaque fois que la chose est possible. Parler de la construction des mécaniques d'orgue dans toute leur complexité nous entraînerait trop loin. En quelques mots, les touches agissent par traction sur de fines lames de bois ou matériaux modernes - les vergettes - ou par poussée sur des tiges, les pilotes, ces pièces étant munies d'écrous de réglage. Quand il faut inverser le sens du mouvement, on met des balanciers articulés vers leur centre. On emploie aussi des équerres mobiles pivotant au niveau de leur coude, pour passer d'une traction verticale à une traction horizontale ou encore pour s'adapter à un changement de direction dans le même plan. Mais l'écartement des touches des claviers, des touches du pédalier et des soupapes des sommiers n'est pas le même. Dans les cas simples, des balanciers en éventail peuvent suffire. Dans les autres cas, un abrégé, long panneau portant une série de tiges pivotantes sur lesquelles sont fixées les petites équerres, permet de passer, par exemple, des 56 touches serrées d'un clavier aux 56 gravures de largeur variable réparties sur un ou plusieurs sommiers.
|
